1281
Pendant l’inondation de 1281, les eaux remplissaient toute la place Maubert; on allait, dit Guillaume de Nangis, en bateau jusqu’à une croix appelée la Croix Hémond, qui était au bas de la rue de la Montagne-Sainte-Geneviève. Exalia parte infra muros usque ed crucem Hemondi, per totam plateam Maberti vasa navalia discurrebant.
Les deux ponts de Paris, le grand et le petit, furent renversés. Ils furent rebâtis en pierre et couverts de maisons.
1296
Quinze ans après, c'est-à-dire en 1296, la rivière déborda, et, d’après Guillaume de Nangis, cette inondation fut réellement extraordinaire. «Non seulement les dehors de Paris furent inondés comme en 1821, mais tout l’intérieur de la partie qu’on nommait la ville fut entièrement couvert d’eau, et la réserve de quelques rues plus élevées que les autres. Aussi, le même auteur ajoute qu’aucun âge ne se souvenait d’en avoir vue de pareille et qu’on n’en lisait aucun exemple dans les historiens (BONAMY, Mémoire sur l’inondation).»
Les deux ponts, chargés de maisons, ne purent tenir contre la violence des eaux. O fut obligé, pendant huit jours, de porter dans le bateaux des vivres aux habitants.
XIVe siècle
Au commencement du XIVe siècle, le Petit Pont devint le centre de tous les apothicaires, qui s’installèrent, soit dans les maisons même de ce pont, soit aux alentours.
Leur bureau était cloître Sainte Opportune.
En 1857, on à trouvé, dans la Seine, un plomb qui, précisément, intéresse la corporation des apothicaires, dont les patrons étaient saint Côme et saint Damien. Ce plomb, qui a été déposé au musée de Cluny (collection Forgeais), porte, au revers, une spatule et un bocal, et au dessous, la date de 1538.
1325
«Et en cest an, par le grand yver qui, par l’espace IX sepmaines, avoit duré, le lundi jour de feste de l’Apparition (le jour de la Tiphaine, 6 janvier), nostre seigneur Charles, le roy de France et Ysabel d’Angleterre, sa sœur, et aultre grans gens estant au palaiz de Paris, par la ravine des grans glachons courans aval par l’eaue de Sainne, deux des grandez archez dur Grand-Pont de Paris et tout Petit-Pont (qui estoient de feust de bois), abatirent, avec aultrez grans dommaigez que au pont de Charenton et ès aultrez édiffices de dessus de Sainne firent. Et lors esconvint, par l’espace de V sepmaines, des viandez de dehors apporter ès nefz et en bateaux secourre à ceux de la Cité.» (Extrait de la chronique Parisienne anonyme de 1316 à 1339, précédée de la chronique Française dite de Guillaume de Nangis (1206-1216)
1369
En cette date, sous Charles VI, et Jacque Aubriot étant prévost de Paris, le Petit-Pont fut reconstruit en même temps qu’on éleva à l’entrée de ce pont, le Petit Châtelet.
Durant le temps du roi Charles sixiesme,
Qui du François porta le diadème
Furent bastiz Chastellet, Petit-Pont
Desquels deulx lung à l’autre correspont
Un titre de l’abbaye de Saint-Victor nous apprend que «les apparaulx de pierre de taille et autres matières qui avaient été réunis, sous Charles V, pour séparer le canal de la bièvre et faire un aqueduc pour faire passer l’eau à travers les fossés et arrière fossés de la ville «furent depuis pris et employés » en l’édifice du Chastelet du Petit-Pont.»
Le Petit-Châstelet servait, du côté de la rive gauche, d’entrée au Petit-Pont. C’était une construction massive sans caractère architectural. Il n’en fut pas moins un objet d’admiration pour ses contemporains :
«Là est Petit-Châstelet », a écrit Raoul de Presles, « si espés de mur qu’on y meuroit bien par-dessus une charrette. Si sont dessus ces murs beaux jardins ; là est une viz double, dont ceulx qui montent par une voie ne s’aperçoivent point des autres qui descendent par l’autre voie.»
«Dans un acte de 1402, qui en donnait la jouissance aux Prévost de Paris (ils logeaient auparavant à l’Hôtel de Ville, près le Saint Esprit en Grève), le Petit-Châtelet est qualifié d’habitation honorable, honorabilis Mansio.
Le Petit-Châtelet devint, par la suite, une prison qui, dans les derniers temps, reçut particulièrement des prisonniers pour dettes. Rappelons, à cette occasion, que le clergé de Notre-Dame y faisait des stations, pendant lesquelles le premier en dignité de ce clergé entrait au Petit-Châtelet, et y délivrait un prisonnier qui le suivait jusqu’à l’église métropolitaine.
Adjugé en 1724 à Hôtel-Dieu, qui ne put mettre à profit ce don royal, pour accroître ses bâtiments, le Petit-Châtelet fut démoli en 1782.
En 1850, lors de la réédification du Petit-Pont, on découvrit quelques restes du pont de Charles VI et les substructions du Petit-Châtelet.
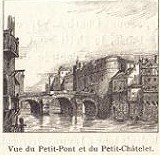
1394
Juvénal des Ursins et la Chronique de Charles VI racontent que, lorsqu’on eut formé le projet de chasser les juifs du royaume, sept d’entre eux furent accusés d’avoir assassiné un des leurs, qui s’était converti. Celui-ci se nommait Denis de Machault. Les sept prévenus durent recevoir, pendant quatre dimanches, le fouet par tous les carrefours de Paris. La moitié de cette peine leur fut remise moyennant 18 000 livres d’or qui furent appliqués à la reconstruction du Petit-Pont. Charles VI en posa la première pierre. Commencés au mois de juin 1394, les travaux s’achevèrent en 1405. Sauval, d’après les comptes de Jean de la Chapelle, payeur des œuvres de la ville, estime que sa reconstruction coûta 21 798 liv., 3 sols, 10 deniers.
1408
« Du mardy dernier jour de janvier 1407, ce jour ne vindrent point les seigneurs de céans au Palais, ne avocats, ne procureurs, ne parties, fors un petit nombre ; pour le grand péril que chacun voit, pour cause des grandes et horribles glaces, qui dès hier au soir commencèrent à descendre par les ponts de Paris et par espécial par les petits ponts . . . . . puis la Saint-Martin dernière passée, a été telle froidure . . . . . que nul ne povait besogner ; le greffier même, combien qu’il eût prins de lez lui en une pélette pour garder l’encre de son cornet de geler ; toutes voyes l’encre se geloit en sa plume, de deux ou trois mots en trois mots, et tant que enregistrer ne povoit. Par icelles gelées ont été gelées les rivières et enspécial Seine ; tellement, que l’en cheminoit et venoit et alloit l’en et menoit voitures par-dessus la glace . . . . . . . Tant que Paris avoit grande nécessité, tant de bois que de pain, pour les moulins gelez, se n’eust été les farines que l’en y amenoit des pays voisins ; et quoique les dites gelées, glaces et froidures se fussent amodérées dez vendredi dernier passé . . . . . et que les glaces se fussent dissolues par parties et glaçons, iceux glaçons par leur impétuosité et heurts ont aujourd’hui rompu et abattu les deux petits ponts ; l’un qui étoit de bois, joignant le Petit Châtelet ; l’autre de pierre appelé le Pont Neuf (le pont Saint Michel) qui avoit été fait puis 27 ou 28 ans ; et aussi toutes les maisons qui étoient dessus, qui étoient plusieurs et belles, en lesquelles habitoient moult de ménaïgiers de plusieurs états, marchandises et métaux . . . . . et nonobstant la dite ruine, pestilence et péril merveilleux, n’y a eu aucune personne périllée, Dieu mercy : car le dit cas est venu et a été puis sept ou huit heures du matin, jusques à une ou deux heures après midi ; combien que se n’eussent été les piliers pieça faits et commencez entre le dit Petit Châtelet et l’Hôtel-Dieu, Notre-Dame, qui ont reçu les premiers heurts des dites glaces et glaçons, qui par ce ont été débrisez, et leur impétuosité amendrie ; vraisemblablement étoit et est que la dite avanture, cas et pestilence des dits ponts fut advenue en cette nuit dernière, en la destruction des corps humains qui ne pussent avoir gardé, ne fuir pour le cas soudain. Outre que ce qui est, ont été rompus et destruicts les moulins de l’évêque de Paris qui sont dessus le Grand-Pont et plusieurs autres ; et aussi churent en la rivière grande partie des changes dessus le dit Grand-Pont qui vraisemblablement et selon l’opinion de ceux qui le connoissent, eut esté abattu par les glaces, ne se fust les heurts qui rompoient les moulins dessus dicts qui sont près et au dessus ; et aussi que les glaçons sont descendus par le dit pont plus tard des douze heures, que par les dits petits ponts ; pour ce que les glaçons qui descendoient de haut ne povoient avoir leur cours vers Saint-Pol et devers la Grève pour ce que cette partie était encore gelée. . . . .(Registres du parlement)
« Pource que, disent les mêmes registres, les maîtres ou Seigneurs conseillers séans et demourants par delà les petits ponts, qui étoient environ trente au plus, ne pouvoient venir au Palais, ne en la Chambre de Parlement, sûrement, pour le grand excez de la rivière qui s’étendoit en plusieurs rues moult impétueusement ; a été aujourd’hui ordonné que les dits Maîtres se assembleront en leur marche et jugeront procès, jusques à ce que seurement l’on puisse céans venir en bastel. »
1409
L’année suivante, en 1409, Charles VI fit don à la ville du Petit-Pont et lui permit d’y élever des maisons. Mais le Petit-Pont ne fut reconstruit qu’en 1416 et les maisons ne furent réédifiées qu’en 1452.
1416
Au mois d’avril 1416, on établit, au pied du Petit-Châtelet, une boucherie de dix étaux, dite du Petit-Pont ou gloriette, pour remplacer la grande boucherie, sise devant Le Châtelet, qui avait été démolie.
Quand on voulait qualifier un langage grossier on disait : « c’est la langue des trippières du Petit-Pont.) – Il emploia, dit l’Estoile (Mémoires journaux) toute la rhéthorique des trippières du Petit-Pont à dénigrer le Roy.»
1418
En cette année nous trouvons au nombre des habitants du petit pont, Perrinet Leclerc, qui introduisit les Bourguignons à Paris et dont le père était un riche marchand de fer.
On sait que Perrinet Leclerc n’ayant pu obtenir justice du chef des Armagnacs, qui l’avaient mal traité, déroba à son père, quartenier de la ville, les clefs de la porte Saint-Germain (des-Près. Il fut trouvé mort quelques jours après, frappé, dit-on, par la propre main de son père.
1463
Depuis saint Louis, les bâtiments de l’Hôtel-Dieu s’étaient multipliés entre la rivière et la rue Sablon. Ils vinrent aboutir au Petit-Pont, « où il y avait une chapelle, connue
Sous le nom de la chapelle de Saint-Agnès, indépendante de celle de Saint-Christophe, qui fut bâtie ou plutôt rétablie par les soins d’Oudart le Morceux, changeur et bourgeois de Paris. » (Essai historique sur l’Hôtel Dieu de Paris par Rondonneau de la Motte)
Oudart de Mocreux en surnom,
Changeur, homme de bon renom,
Et bourgeois de Paris jadis
Que Dieu mette en son paradis,
A fait faire cette chapelle
En cet Hôtel-Dieu, bonne et belle,
Bien ornée de verrières, et est ornée de chiaires
Et plusieurs autres bien notables, etc., etc. . . .
Cette chapelle fut démolie pendant la Révolution.
« En 1463, les Frères et Sœurs de l’Hôtel-Dieu acquirent plusieurs pans autour de cette dernière chapelle et y firent construire une entrée nouvelle et un portail.
« Par un arrêt de l’année 1511, ils firent fermer la rue du Sablon, après avoir fait l’acquisition de sept maisons qui appartenaient à l’abbaye de Sainte-Geneviève.
« Enfin, en 1531, les administrateurs traitèrent d’une maison situé sur le Petit-Pont, laquelle joignait le portail dont nous venons de faire mention. Sur l’emplacement de cette maison, qui avait appartenue à la Sainte-Chapelle, le cardinal autorisa Duprat, légat de France, à faire construire la salle qu’on appela jusqu’en 1772, « la salle Légat ». (Tableau hist. Et pitt. De Paris)
Cette salle que le cardinal Duprat avait fait élever de ses propres deniers, contenait cent lits. Le pignon, décoré dans le style de la Renaissance, venait s’accoler, à l’entrée du Petit-Pont, à celui de la salle Saint-Louis.
1507
Sauval cite un arrêt du Parlement de l’an 1507, qui ordonne que la rue qui conduit du Petit-Pont au pont Notre-Dame serait rehaussée de dix pieds, afin de la mettre à niveau avec ces deux ponts.
Nous rappellerons qu’en 1740, lorsqu’on travaillait à la construction de l’aqueduc sous lequel passait la conduite d’eau des pompes du pont Notre-Dame à la fontaine Saint-Michel, on a trouvé des restes du pavé de Philippe Auguste, à six pieds sous le pavé de la rue du Petit-Pont. « Cet ancien pavé était composé de grandes pierres inégales, épaisses de 8 à 10 pouces et longues de 3,4 ou 5 pieds. Ce pavé est de la première époque de l’élévation du terrain de Paris : dans la suite, la construction des ponts de pierre et le nouveau pavé, si souvent relevé, contribuèrent beaucoup à l’exhaussement. »
Bonamy ajoute : « et je ne sais si ce n’est encore une preuve que le lit de la rivière dans ce canal était aussi moins élevé qu’il n’est présent. Il n’était alors rétréci ni par les bâtiments de l’Hôtel-Dieu, ni par les maisons de la rue de la Bûcherie : tout à bord de la rivière était ouvert et servoit de port, où abordoit les marchands et surtout le bois. » (Mémoire sur l’inondation de la Seine à Paris, 1740 par Bonamy)